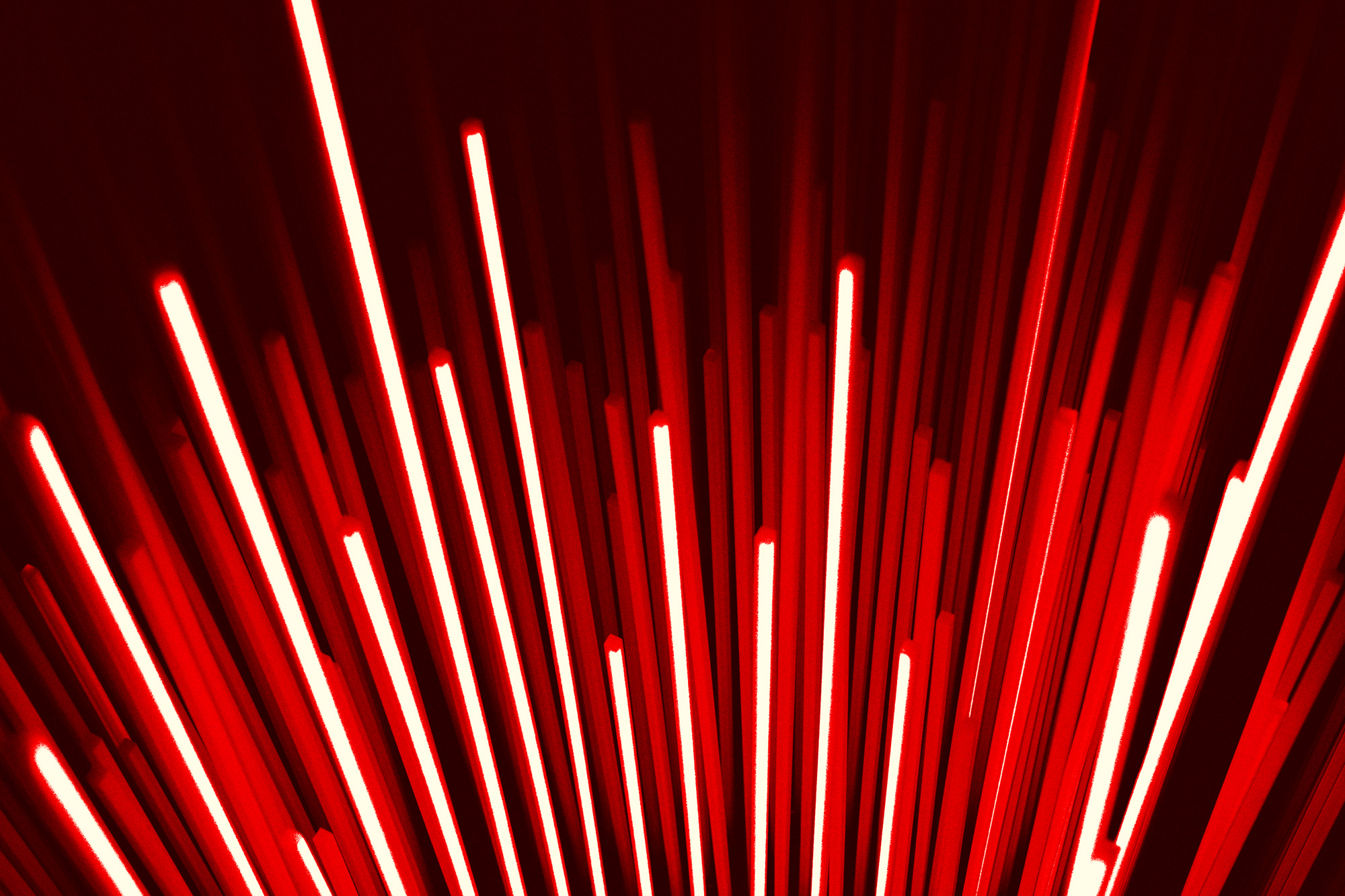18 Déc CAS Rythmes urbains et sécurité : les essentiels #1 Ville et mobilité
Le Laboratoire de Sociologie Urbaine – LaSUR et iSSUE s’associent pour offrir aux professionnel·le·s qui gravitent autour de la ville au sens large (urbanisme, mobilité, sécurité, travail social, événementiel…) une nouvelle opportunité de formation continue qui démarrera en septembre 2025 : le Certificate of Advanced Studies (CAS) « Rythmes urbains et sécurité – Travailler ensemble face aux enjeux de la cohabitation urbaine ».
Dans le cadre du lancement de cette nouvelle offre, nous avons organisé trois webinaires. Le premier, consacré au thème « Ville et mobilité », s’est déroulé le 7 octobre et peut être visionné ici : https://www.youtube.com/watch?v=fcZFPt0dOpc&t=845s.
Il était animé par Pascal Viot, directeur d’iSSUE et coordinateur du CAS, en collaboration avec Vincent Kaufmann, Professeur de sociologie urbaine et directeur du LaSUR, et Guillaume Drevon, collaborateur scientifique au LaSUR et spécialiste des rythmes. Les trois experts ont notamment abordé les sujets suivants :
Qu’entend-on par « Rythmes urbains » et en quoi la question des rythmes est-elle une grille de lecture pertinente pour comprendre les enjeux de la ville d’aujourd’hui ?
Dans les villes, il y a des variations d’intensité et de flux qui engendrent des enjeux au niveau de la mobilité et de la sécurité. La notion de rythmes se décline en trois aspects :
👉 La mesure de l’intensité des flux : nombre de passagers, flux de voitures
👉 Les agencements : Il y a une mosaïque d’usages qui se déploient dans l’espace et dans le temps. Certains usages vont cohabiter, avec un risque de conflit, d’autres vont être décalés dans le temps. Comprendre l’agencement des différents usages de la ville est important pour comprendre la mobilité, les différentes activités qui y ont lieu et plus largement l’agencement des relations sociales.
👉 Les patterns : Identifier des patterns, c’est identifier la répétition de phénomènes dans l’espace et dans le temps. Le pattern le plus connu est celui du déplacement du domicile vers le travail. Il y a aussi le pattern des jours fériés ou encore celui des festivals. En y intégrant la notion de rythmes, de flux et d’agencements, on va pouvoir définir une politique publique de sécurité ou de gestion de la mobilité.
On s’aperçoit que les politiques de mobilité, et notamment de transports, sont calées sur un seul pattern, celui du « métro-boulot-dodo ». Lorsqu’on essaie de comprendre la diversité plus large des rythmes de vie en Suisse, on voit que la part des personnes qui utilisent les transports publics en mode « métro-boulot-dodo » ne représentent que 20% de la population. Le constat est donc que l’offre n’est pas ajustée à la demande.
Ce qui va nous intéresser dans le CAS, c’est justement les moments où le modèle prédominant (métro-boulot-dodo) est perturbé par d’autres usages ou d’autres temporalités (pannes dans les réseaux, métro-boulot-fiesta, etc.). Cela va nous amener à nous poser la question de l’offre de transports, mais aussi de l’étalement des flux et des concentrations de personnes sur certaines heures un peu alternatives, comme la fin de nuit.
Comment la compréhension des enjeux de mobilité quotidienne peut-elle nous aider à comprendre les défis liés à une mobilité plus exceptionnelle, notamment lors d’événements ?
Dans le cas des événements, on assiste à un conflit entre des vitesses et des rythmes différents. Prenons l’exemple du Montreux Jazz Festival : la ville entre dans un rythme particulier pendant cette période, alors que d’autres gens continuent à vivre leur vie quotidienne. Il faut réussir à penser des vitesses différentes, des transitions et ça nécessite de déployer de nouveaux savoir-faire.
L’exemple de la ville de Grenoble
Depuis une dizaine d’années, on a des politiques publiques qui pensent le ralentissement et qui imposent des limites de vitesse, que ce soit dans les villes ou à une échelle régionale ou nationale. Ces politiques font débat.
La ville de Grenoble est la première à avoir mis en place une telle mesure.

Dans ce reportage, on évoque différents aspects liés à la limitation de la vitesse :
👉 l’enjeu écologique
👉 la cohabitation entre les voitures, bus, vélos ou trottinettes, qui ont des vitesses différentes
👉 une meilleure qualité de vie
👉une dimension de sécurité, en lien avec la réduction des accidents et de leur gravité
La question se pose aussi de notre relation à la vitesse, à la technologie et au progrès. Même dans un segment de vitesse qui était considéré comme lent (le vélo), on assiste aujourd’hui à des conflits de rythmes selon la puissance des vélos, électriques ou non. Faudrait-il prévoir différentes limitations ? Comment faire un pas de côté pour trouver une solution qui convienne à tous ?
La mobilité mise à l’épreuve du régime événementiel
L’exemple des JO de Paris :
👉 L’avant, avec Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, qui parle du concept de mobilité imaginé par les autorités
👉 L’après, avec le témoignage de satisfaction des participants
On constate que l’approche en matière de mobilité partait d’une vision plutôt négative et a glissé vers une sorte de miracle bienheureux. Cela inspire les questions suivantes :
👉 Comment a-t-on obtenu une expérience de mobilité améliorée ?
👉 Qu’est-ce qu’on peut garder ou apprendre de ces grandes manifestations, notamment sur le parcours d’expérience ?
👉 Comment informer le citoyen du mode d’emploi de la ville pour qu’il se l’approprie ?
Envie d’en savoir plus sur le Certificate of Advanced Studies « Rythmes urbains et sécurité » ? Inscriptions et informations ici : https://www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/rythmes-urbains-securite-cas/